Né en 1923, il avait vingt ans lorsque la marine impériale japonaise l'appela pour combattre à Taïwan et aux Philippines, de 1943 à 1946. Il expliquera plus tard que cette période a déterminé son approche cinématographique singulière de la violence, qu'il jugea depuis lors « grotesque, absurde ». De retour au Japon, il reprit ses études à l'université d'Hirosaki, puis échoua à l'examen d'admission de l'université de Tokyo, où il envisageait de se former au commerce. Il décida alors de changer d'orientation pour apprendre le cinéma, plus par dépit (et à la faveur d'une concomitance fortuite entre l'examen d'entrée à la Shochiku et celui pour l'université de Tokyo) que par vocation.
Après de brèves études à l'académie de cinéma de Kamakura, il fut engagé comme assistant-réalisateur par la Shochiku à l'automne 1948. Il y assista brièvement divers réalisateurs avant de choisir l'équipe de Tsuruo Iwama, un réalisateur aujourd'hui oublié qui lui transmis un certain sens de la convivialité, à défaut d'une connaissance approfondie du milieu artistique ou de l'actualité cinématographique. Il quitta cette société pour les studios Nikkatsu dès 1954, tandis que les futurs prodiges de la nouvelle vague japonaise tels que Masahiro Shinoda, Nagisa ?shima ou encore Yoshishige Yoshida commençaient à rejoindre la Shochiku. Suzuki indiquera plus tard que les motivations de ce changement étaient matérielles, la Nikkatsu lui offrait de meilleures perspectives d'avancement et un salaire largement supérieur ; son choix n'était pas lié au type de productions, aux conditions de travail, ou aux partis pris esthétiques des différents studios.
La Nikkatsu lui offrit en effet, dès 1956, l'occasion de réaliser un premier long métrage À la santé du port - La victoire est à nous (Minato no kanpai : Shori wo wagate ni), sous le nom de Seitar? Suzuki (il adopta le prénom d'artiste Seijun à partir de La Beauté des bas fonds - Ankokugai no bijo - en 1958), immédiatement suivi de La pureté de la mer (Umi no junjo) et de Le Quartier du mal (Akuma no machi). Sa carrière de réalisateur était lancée, mais circonscrite à la réalisation de films de série B, des réalisations peu coûteuses prévues pour être diffusées en première partie de soirée, avant le feature film. En effet, entre la fin des années 1930 et le début des années 1970, les salles de cinéma japonaises avaient pour habitude de projeter deux films successifs au cours d'une même séance ; le premier, qui était considéré comme un film mineur (dit de série B), servait de hors d'oeuvre au film principal, et devait déployer suffisamment d'originalité stylistique pour ne pas déflorer les procédés esthétiques mis en oeuvres dans le film principal et ne pas paraître ridicule en comparaison avec ce dernier malgré un budget nettement moins confortable.
Les conditions de travail à la Nikkatsu étaient très dures pour les jeunes réalisateurs. Suzuki devait travailler vite, tourner quatre ou cinq films par an, et sa marge de décision était restreinte. Les studios Nikkatsu lui imposaient les scénarios (les genres des films de la Nikkatsu étaient alors presque invariablement le yakuza-eiga, film de yakuza et le pinku eiga, film rose), le format et la durée précise du film et les acteurs devaient être choisis parmi ceux qui étaient liés à la société de production. La pression sur les réalisateurs de films pour le cinéma était intense, car les sociétés de productions subissaient alors un vertigineux déclin d'audience lié à l'adoption croissante de la télévision dans les foyers japonais au fil des années 1960 (1 milliard et 127 millions entrées de cinéma vendues en 1958 pour seulement 313 millions d'entrées - le tiers - 10 ans plus tard, en 1968). Suzuki réussit néanmoins à se faire reconnaître comme un réalisateur de séries B rentables par les dirigeants de son entreprise, et son travail s'inscrivait parfaitement dans la nouvelle orientation stratégique de la Nikkatsu, qui avait alors décidé de se recentrer sur la production de seishun-eiga (films pour la jeunesse) pour faire face à la crise.
Cette relative confiance des producteurs ne dura pas, car Suzuki insufflait un style de plus en plus personnel à ses films. Tandis que son savoir-faire s'affirmait, ses polars supportant parfois la comparaison avec les oeuvres de
Jean-Pierre Melville, son travail était progressivement marqué par un humour absurde, une mise en scène surréaliste, et des expérimentations visuelles déconcertantes (toutefois étayées par une photographie encore académique et très soignée). L'empreinte de l'auteur devint prééminente à partir du diptyque de 1963, Détective bureau 2-3 (Tantei jimusho 23: Kutabare akuto-domo) et La Jeunesse de la bête (Yaju no seishun), les premiers films où joua son acteur fétiche aux bajoues si surprenantes,
Jo Shishido, qu'on retrouve dans La Marque du tueur. Bien que ces oeuvres lui valussent le soutien d'un public de cinéphiles et de grands auteurs comme ?shima, la Nikkatsu, conservatrice et plus désireuse de produire des oeuvres formatées pour le marché, supporta difficilement les audaces de ce jeune iconoclaste. Les producteurs le menacèrent, sans succès.
De fait, Suzuki radicalisa son approche lorsqu'il réalisa coup sur coup, en 1966 et 1967, ses deux oeuvres les plus extravagantes.
Le Vagabond de Tokyo (T?ky? Nagaremono, 1966) est un yakuza-eiga au scénario -- imposé -- assez classique, mais Suzuki sublima les contraintes (petit budget, beaucoup de scènes en studio, ...) pour mettre en oeuvre une esthétique visuelle entre kitsch et pop-art (décors et filtres jaune citron, ou mauves, combats stylisés dans la neige, plans entre cabaret mélancolique et comédie musicale, ...), un travail original et volontariste de mise en scène souvent proche du théâtre (ostensiblement inspirée du kabuki), et, exploitant le thème musical éponyme (parfois chanté par l'acteur
Tetsuya Watari lui-même), nostalgique et langoureux, il imprégna son film d'une suavité onirique touchant à l'érotisme, inattendue dans un genre de polars plutôt codifié et sombre.
Mais l'apogée, et la chute, survinrent avec
La Marque du tueur (Koroshi no rakuin), en 1967. Comme dans Le Vagabond de Tokyo (mais cette fois en noir et blanc, tout en clairs-obscurs et jeux d'ombres caressantes), la lumière et la photographie cinémascope donnaient à l'image une certaine sensualité, au service de la présence charismatique d'un Jo Shishido figurant, plus que jamais, une incarnation japonaise de
Marlon Brando. Tout concourait à donner à ce film une esthétique étrange et maniérée, une bizarrerie baroque. Le genre était stylisé à l'extrême, épinglé dans des clichés ironiques de film noir, frisant la parodie, si bien qu'on pourrait parler d'une épure de polar, très proche, en ce sens, du Alphaville de
Godard (sorti deux ans auparavant, en 1965). Le montage accentuait cet effet de condensation, sans pour autant faire obstacle à l'intelligibilité du récit : les plans s'enchaînaient de façon très rapide et parfois inattendue, brisant la linéarité narrative, et donnant au film un rythme parfois syncopé et haletant.
Ce film fut le coup de grâce pour Kyusaku Hori, alors président de la Nikkatsu, qui le qualifia d'incompréhensible et invendable, et licencia Suzuki fin avril 1968.
Malgré le soutien de nombreux jeunes réalisateurs, et des manifestations d'étudiants et de cinéphiles (on parle souvent à ce sujet d'une « affaire Langlois japonaise »), Suzuki fut banni des studios et ne put tourner aucun film pour le cinéma pendant les dix années suivant son licenciement de la Nikkatsu. Il engagea (le 7 juin 1968) et remporta (le 12 février 1971) un procès contre son ancien employeur durant lequel il révéla que la réalisation de La Marque du tueur lui fut confiée en urgence, avec un délai pré-établi et très serré, et qu'il suggéra d'abandonner ce projet tant le script était complexe (il était pourtant, et pour la première fois, co-auteur du scénario qu'il dirigeait). Mais il était déjà trop tard pour qu'une réhabilitation judiciaire et les excuses publiques de Kyusaku Hori lui épargnent l'oubli de la critique et des distributeurs ou l'absolution des grandes sociétés de production japonaises .
Durant cette traversée du désert, Suzuki dut se résigner à tourner des réclames, des films de commande pour la télévision, et même une anime ; un projet de long métrage sous l'égide des studios Toei avorta, mais il trouva l'occasion d'écrire quelques livres.
Après que son procès fut clos, il réalisa Histoire de mélancolie et de tristesse (Hish? monogatari) en 1977 (produit par la Shochiku), et une série de trois films souvent appelée Taish? Trilogy (trilogie dont l'intrigue se déroule durant l'ère Taish?, c'est-à-dire les années 1910-1920). Le premier volet de cette trilogie, Mélodie Tzigane (Tsigoineruwaizen, 1980), produit par Art Theatre Guild, fut sélectionné pour un Ours d'argent au festival de Berlin et obtint finalement une Honourable Mention. Bien qu'au Japon ce film soit généralement considéré comme un des chefs d'oeuvres de Suzuki (il fut par exemple primé « Film de l'année 1981 » et « Meilleur réalisateur 1981 » au Japanese Academy Awards) il fut rarement distribué à l'étranger. Réalisé l'année suivante, Brumes de chaleur (Kager?-za), le second volet, connut un moindre succès, et ce n'est que dix ans plus tard, en 1991, que le film Yumeji termina la trilogie. Bien que ce dernier volet n'obtînt pas de grand prix, son thème musical, composé par Shigeru Umebayashi, fut repris comme thème principal dans la bande son à succès d'
In the Mood for Love de Wong Kar-wai.
Mais Suzuki était alors un artiste oublié, ces nouvelles oeuvres furent peu diffusées, et la critique se désintéressait de lui. Il lui fallut attendre le début des années 1990, et plus précisément une rétrospective organisée en 1991 par Marco Müller à Rotterdam (précédée de peu par une rétrospective moins médiatisée au Edinburgh Film Festival de 1988 ), pour être largement reconnu. Des réalisateurs de renom lui rendirent alors hommage, et ses films furent montrés dans les festivals de cinéma internationaux. Cela lui permit de trouver les financements nécessaires pour réaliser de nouveaux longs métrages, tels que Pistol Opera (Pisutoru opera, 2001), un prolongement (ou peut-être une parodie) de La Marque du tueur, et plus récemment la surprenante comédie musicale Princess Raccoon (Operetta tanuki goten, 2005) dont l'actrice principale est la Chinoise
Zhang Ziyi.
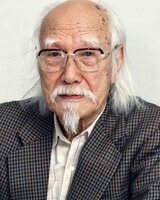




 Store
Store
 “ Les enjeux scénaristiques aux oubliettes, la Marque du tueur n'existe que pour sa mise en scène, Suzuki est un esthète. ”
— Store
14 juin 2014
“ Les enjeux scénaristiques aux oubliettes, la Marque du tueur n'existe que pour sa mise en scène, Suzuki est un esthète. ”
— Store
14 juin 2014
 Kronan
Kronan
 “ Grand créateur de forme, Suzuki joue de l'artifice filmique et submerge son film d'une expression visuelle novatrice et emblématique. ”
— Kronan
16 avril 2014
“ Grand créateur de forme, Suzuki joue de l'artifice filmique et submerge son film d'une expression visuelle novatrice et emblématique. ”
— Kronan
16 avril 2014
 Kronan
Kronan
 “ L'abstraction noie ce film dans une expérimentation totale et marque définitivement Seijun Suzuki comme un grand cinéaste. ”
— Kronan
7 avril 2014
“ L'abstraction noie ce film dans une expérimentation totale et marque définitivement Seijun Suzuki comme un grand cinéaste. ”
— Kronan
7 avril 2014
 MarcFairbrother
MarcFairbrother
 “ On a parfois l'impression que pour Suzuki le cinéma n'est qu'un prétexte à des expérimentations chromatiques. Dans ce cas ci, c'est sublime. ”
— MarcFairbrother
29 septembre 2013
“ On a parfois l'impression que pour Suzuki le cinéma n'est qu'un prétexte à des expérimentations chromatiques. Dans ce cas ci, c'est sublime. ”
— MarcFairbrother
29 septembre 2013
 Store
Store
 “ Difficile de dire si Suzuki met en scène ou compose juste des plans tant TD est d'un esthétisme pur, reléguant l'histoire au second plan. ”
— Store
13 juin 2014
“ Difficile de dire si Suzuki met en scène ou compose juste des plans tant TD est d'un esthétisme pur, reléguant l'histoire au second plan. ”
— Store
13 juin 2014




