Take Shelter : Jeff Nichols est-il le successeur de Terrence Malick ?
Alors qu'il n'a même pas 35 ans, le cinéaste Jeff Nichols impressionne par sa maîtrise narrative et technique dans ses deux premiers films : Shotgun Stories et Take Shelter, aujourd'hui à l'affiche. Originaire de l'Arkansas, il représente déjà la nouvelle garde du cinéma du sud des Etats-Unis, à l'image de son allié David Gordon Green, mais surtout de son père spirituel Terrence Malick. Une nature dont on ne peut se défaire, des valeurs familiales cardinales, les deux réalisateurs semblent partager le même point de vue sur le monde.

Traditions et trajectoires particulières
De l'Arkansas à l'Ohio (dans Take Shelter), du Dakota du Sud au Texas pour Malick, les deux hommes aiment à mettre en scène des paysages florissants, foisonnants, couvrants sous leur stature des villes très tranquilles. Un regard âpre parfois, mais délicat, patient. Dans ces territoires souvent oubliés par le cinéma américain, on s'inquiète d'autres traditions, d'autres souvenirs. Ceux d'une Amérique moins grandiloquente, qui tente de vivre en harmonie avec son environnement, d'en utiliser les ressources pour s'enrichir financièrement comme spirituellement. Ce n'est pas pour rien que Malick narrait la fondation des Etats-Unis dans Le Nouveau Monde. Cette époque perdue les inspire l'un comme l'autre. De ce monde bien établi, de ces habitants qui ne veulent pas faire de vague, Malick en tire des portraits touchant parfois au sublime (The Tree of Life) là où Nichols aiment surtout mettre en exergue les éléments qui sortent du rang. Là où le monde rural écrase parfois ses habitants, et où les habitudes et le quotidien mutent doucement en folie. Nichols déclarait ne pas savoir vouloir devenir un réalisateur du « sud » ou « rural » avant qu'il ne rejoigne la School of Arts de Caroline du Nord. Depuis, il fait preuve d'une attention tout particulière pour ses origines, le décor de son enfance, et ne peut se résoudre à tourner dans une grande cité.
Dans Shotgun Stories, c'est en montrant une fratrie en affronter une autre, eux qui partagent le même père disparu, que Nichols exprime le désarroi face à une nouvelle famille disloquée, changeant de visage à l'envi, mais dont les racines (une mère perturbée, un père violent) semblent empoisonnées.
Des funérailles très tendues extrait de Shotgun Stories
Courber l'échine devant les cieux
Il y a le même rapport obséquieux et empreint de respect envers la nature dans la filmographie de Terrence Malick que dans celle de Jeff Nichols. Si on célèbre le berceau de l'humanité dans les films du premier, sans tomber dans la fable écologique militante, on éprouve le même type de fascination dans Take Shelter, pour ses manifestations potentielles, son grondement, la façon dont la nature pourrait s'emporter. Dans Phénomènes, de M. Night Shyamalan, la même force invisible soulevait la nature contre ses habitants, les poussant à se retirer, se cacher, leur interdisant tout contact entre eux au risque de disparaître. Ici, il n'y a que Michael Shannon qui observe ses dysfonctionnements, la menace potentielle, et personne pour corroborer ses visions prédicatrices. A aucun moment il ne sera question de combattre la nature ; comme chez Malick, le choix est simple : fuir ou attendre, et se laisser ainsi emporter par le tourbillon.
Seul dans la nuit extrait de Take Shelter
Cette révérence, Nichols en fait preuve également envers son maître à penser Terrence Malick. S'il qualifie The Tree of Life « d'espèce protégée qu'il faudrait chérir », c'est sûrement parce qu'il y est fait étal du même respect, de la même tendresse pour les forces de la nature, le cocon familial et ses liens indivisibles. Et s'il ne se dit pas particulièrement cinéphile, le jeune cinéaste avoue dévorer toujours avec la même ferveur une poignée de films : L'Arnaque, Lawrence d'Arabie, Luke la main froide et bien sûr La Balade sauvage. On y fuit une routine minutieusement ennuyeuse pour s'échapper dans la forêt, s'amouracher de la nature, comme pour revenir vers le mode de vie des premiers habitants de l'Amérique.
La vie sauvage extrait de La Balade sauvage
La famille, point d'ancrage principal de Take Shelter
Ce mode de vie, ce besoin impérieux de constituer une famille justement, est au centre de Take Shelter. Naviguant entre les genres, du conte paranoïaque aigu à la rêverie fantastique, le film retrouve toujours son chemin vers le drame familial, celui d'un homme qui ne sait comment protéger sa famille de tout le mal qui existe dans le monde. Et de la peur panique qui en découle. Si l'amour est en germe dans Les Moissons du ciel, par exemple, il est totalement épanoui dans The Tree of Life et ne peut s'exprimer qu'en totale fusion avec la nature : la voie de la grâce, nous disait le film, celle des hommes, est avant tout celle des hommes qui essaient de se dépasser eux-mêmes, en accord avec leur environnement. Fonder une famille, en prendre soin, en faire son refuge. Si les mêmes paramètres s'appliquent dans le cinéma de Nichols c'est aussi par esprit de revanche. Pour prouver que nos parents, désabusés et violents, ont bafoué le modèle familial. Qu'il est possible de faire mieux.
Explique-moi ! extrait de Take Shelter
Take Shelter naît donc sur nos écrans dans la tempête critique mais sous les meilleurs augures. La silhouette et le courage de Jessica Chastain, transposée d'un cinéaste à l'autre, le magnétisme de Michael Shannon, furieux, scrupuleux, hanté de visions, un rôle qu'il travaille et retravaille depuis Bug (de William Friedkin) et My son, my son, what have ye done? (de Werner Herzog) sont autant d'arguments de poids qui finissent de nous convaincre de l'évidence : nous assistons à l'éclosion d'un prodige du cinéma américain.
Source et citations : Les Inrocks & Trois Couleurs | Image : © Sony Pictures Classics














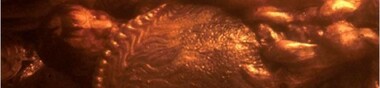


@Cladthom Bien sûr, je suis dans l'exagération. Il y a des petits bouts de cinéma dans Melancholia. Je t'ai déjà expliqué mon agacement.
Mais on ne peut pas dissocier la première et la deuxième partie. Dans la première, on donne à voir l'état de crétinerie de ces gens qui veulent à tout prix "être heureux", "sauver la face", "maîtriser", "accomplir leurs rituels". Pour "oublier la mort" ?
Évidemment, ces gens là, au bonheur forcé, sont les crétins de service pour LVT. Il y a les (extra-)lucides, qui eux, ont tout compris (forcément).
Et le personnage de Claire, qui balance vaguement, faisant le lien entre les deux.
Binaire, stéréotypé, caricatural.
La deuxième partie, c'est la fin du monde, à savoir "on va tous mourir", on n'y peut rien, spammé pendant 5 mn.
Merci LVT, je l'ignorais. Merci de m'avoir apporté la lumière.
Et donc, les imbéciles heureux du début n'ont définitivement rien compris, ils peuvent gesticuler, s'inventer des danses, ils vont crever. D'ailleurs, ces gens-là, LVT ne les aime pas.
Bon, ok. Ça vole pas très haut, mais à la limite, c'est moyennement grave.
Ce qui finit par me les briser menues, c'est le ton professoral et ricaneur, cet espèce de mépris associé à l'affirmation de pensées aussi bêtes, convenues.
La grandiloquence, l'emphase quand elle est maîtrisée (ici donc), ça touche, il y a une vraie beauté direct (pas forcément qu'esthétique) qui s'en dégage.
LVT n'a pas grand chose à dire, ça c'est certain, mais son aspect en gros cathartique de gros adolescent dépressif j'aime bien.
La mélancolie, le désespoir, ok.
La misanthropie, pourquoi pas.
La critique d'une société et d'un cinéma paranoïaques et formatés, ok.
Le style emphatique, ok.
Mais cet aspect ultra démonstratif, didactique, professoral, ce que tu veux, ça marche pas avec moi.
Je ne suis pas son élève, je ne suis pas débile.
Et puis j'aime les gens, mais ça c'est anecdotique.
Enfin, comme je l'ai déjà dit pour Dancer in the Dark, il finit par épouser les mêmes rails que le cinéma qu'il critique : bêtifiant.