Clint Eastwood a-t-il fait une grosse connerie avec American Sniper ?
Qu’est-ce qui est passé par la tête de Clint Eastwood pour faire aujourd’hui American Sniper ? Pourquoi traiter un tel sujet, sans recul, la tête dans le guidon, le 1er degré brandi en étendard, trois ans après le retrait des troupes américaines d’Irak ? Comment peut-il croire que faire corps avec son protagoniste suffit à se passer de la complexité des enjeux moraux et idéologiques inhérente au sujet, comme si Démineurs et Kathryn Bigelow n’avaient jamais existé ? Qui a dit à l’inspecteur Harry que ce serait une bonne idée de prendre symboliquement la place du tueur qu’il traquait dans sa première aventure et de regarder à son tour par la lunette du fusil ? Au garde du corps de JFK de Dans la ligne de mire, hanté par la mort de son président, d’avoir de l’empathie pour ce type assassin?

Il y aura toujours des défenseurs d’Eastwood pour feuilleter leur John Ford ou leur Don Siegel illustrés et affirmer que le cinéaste ne fait rien que les grands maîtres n’ont déjà fait. Stylistiquement, ils n’auront pas tort, mais éthiquement, et sauf erreur de notre part, aucun de ces hommes ne s’est fourvoyé à ce point, pas en temps de paix relatif en tous cas, et encore moins concernant un conflit contesté aussi bien dans ses motivations que dans ses conséquences. Eastwood aurait pu s’inspirer du récit du reporter et lauréat du Pullitzer David Finkel, De bons petits soldats. Une immersion au sein d’un régiment d’infanterie, une vue au ras du sol de l’occupation américaine mais pas au ras des pâquerettes : même s’il ne s’agissait pas de tirer des enseignements globaux et géopolitiques du conflit, il y a avait dans cet ouvrage suffisamment de peurs, de doutes, de courage, de blessures et de solidarité parmi les soldats côtoyés – et chez les irakiens avec qui ils parlementaient – pour qu’on saisisse très bien de quoi il en retournait. Choisir Finkel, cela aurait été se mettre du côté du progrès.
American Assassin
Bizarrement fidèle à la caricature facile que l’on fait de lui, Clint Eastwood a préféré se comporter en Charlton Heston vieillissant, le Moïse défenseur des droits civiques dont il reste aujourd’hui l’image la plus terne, celle de l’odieux vieillard brandissant son fusil devant une NRA aux anges. Alors il a lu autre chose : American Sniper, l’autobiographie de Chris Kyle, le sniper le plus mortel dans toute l’histoire de l’armée américaine. Et il en a fait une hagiographie. Une hagiographie ?! Le réalisateur de Mémoires de nos pères, démonteur de l’indéboulonnable statue d’Iwo Jima, a embaumé dans un film un authentique soldat pour en faire une icône ?! Donc le recul, l’expertise, la mise à distance ne s’applique qu’au passé, pas au présent ? Il y a une scène très éclairante quant à cette vision tronquée des faits. C'est le moment où Kyle, fraîchement entré dans les SEALs, s'entraîne au tir sur cible. Son instructeur lui demande pourquoi il ne ferme pas l'oeil qui ne lui sert pas à viser. Kyle répond que c'est pour avoir une vision plus large et valide son raisonnement en dégommant un serpent. C'est exactement Eastwood sur ce film : un type qui ne voit son sujet qu'à travers la lunette d'un fusil et qui, quand il consent à ouvrir l'autre oeil, le fait seulement pour enfoncer le clou.

De plus éclairés qu’Eastwood auraient retitré le récit de Kyle, American Assassin. De moins éclairés auraient opté pour Captain America 3. Il y a les deux dans cette histoire qui, sur le papier, doit autant à l’héroïsme militaire le plus folklorique, qu’à Henry, portrait d’un tueur en série. Il a beau porter un uniforme, le Chris Kyle d’Eastwood n’est pas seulement le sniper le plus mortel de l’armée US, il est aussi le plus gros tueur jamais engendré par son pays (et on parle d’une contrée qui en a vu défiler un paquet) et le plus gourmand (pour une cible en carton touchée, il vous tue aussi un serpent qui passait par là, cadeau). Cela, Eastwood ne veut pas le voir, fidèle au texte de Kyle qui écrit ne pas se souvenir de ceux qu’il a tués – 160 officiellement, 250 officieusement – mais de toutes les vies qu’il a sauvées.
Ne pas confondre le bon sniper avec le mauvais sniper
On a donc mal compris. Un sniper ne tue pas, il préserve des vies. Tous les snipers ? Oh non. Capitalisant sur le fait que Kyle signale dans son livre l’existence d’un autre franc-tireur surdoué dans les rangs adverses, Eastwood installe un affrontement à distance entre le héros et son double maléfique. Ou malfaisant si vous préférez, mais maléfique conviendrait aussi. Attention, nous ne sommes pas dans Stalingrad, où Jean-Jacques Annaud traitait de manière égale ses deux tireurs, l’un allemand, l’autre russe. Là, ce serait plutôt le sketch des Inconnus expliquant la différence entre un bon et un mauvais chasseur.
Dans le film, le Syrien qui tire pour le compte des insurgés irakiens, c’est un mauvais chasseur : il voit un Américain, il tire. Notre sniper, lui, c’est un bon chasseur : il voit un Irakien, il tire, mais c’est pas pareil, il tue pour protéger. Peut-être son adversaire fait-il la même chose, on ne le saura jamais, puisqu’il n’est rien qu’un démon évanescent (ou alors, il y a un diptyque à attendre, avec la même histoire du point de vue autochtone ? Lettres d’Iwo-Jima semble tellement loin désormais…). Ah ça non, c’est pas pareil et Eastwood l’a bien compris. Chris, c’est un bon chasseur. On en a d’ailleurs la preuve dès le début du film, grâce à un enchaînement de séquence très heureux – et fin, très fin – qui nous voit passer d’un enfant armé dans le viseur de Kyle adulte, à un cerf abattu par Kyle, enfant. Comment ça ? Un enfant combattant et un cervidé, c’est la même chose ? Les défenseurs d’Eastwood ne verront pas là un montage alterné chargé d'une équivalence (cerf = enfant), mais une manière de remonter à la source de la vocation de Kyle en ce moment fatidique, de montrer d'où vient son geste (hypothèse haute : on voit ce qui lui en coûte) ou de rappeler que Kyle lui-même a été un enfant (hypothèse basse : on se retrouve face à un grand enfant qui tire sur un petit enfant ; tout va bien, les voilà d'égal à égal). Sauf que le vrai Chris Kyle a mis un point d’honneur à préciser dans son autobiographie que jamais il n’avait tiré sur un enfant. L’édifice moral qu’il s’était construit pour accomplir sa mission se serait effondré comme un château de cartes. Par contre pour Eastwood, qui déclare que Kyle a menti à ce sujet, ça se discute. Si c’est pour protéger, il faut voir… Protéger une unité ou un soldat américain, pas protéger une quelconque forme d’intégrité. Eastwood veut qu’on puisse rester debout pour se regarder dans un miroir, peu importe si on voit dans son propre reflet un étranger, un être qu’on méprise pour ce qu’il a fait.
Un film de super-héros pour les seniors
Statistiquement, les personnes que l’on diagnostique comme sociopathes dans le civil font de meilleurs soldats, en tout cas maintenant que les armées privilégient l’efficacité meurtrière à la discipline. Le héros psychopathe d’American Sniper fait encore plus fort : il est une armée à lui seul. One man army ou army of one, peu importe l’appellation. Ses camarades l’appellent Légende. Comme s’il était déjà mort à leurs yeux, mais Eastwood n’aime pas le double sens que pourrait avoir cette expression. Légende, c’est parce qu’il est plus fort que les plus forts, qu’il inspire tous ceux qu’il croise. Un symbole vivant et réel. Vous vous souvenez dans Avengers ce que répond Tony Stark à Loki ?
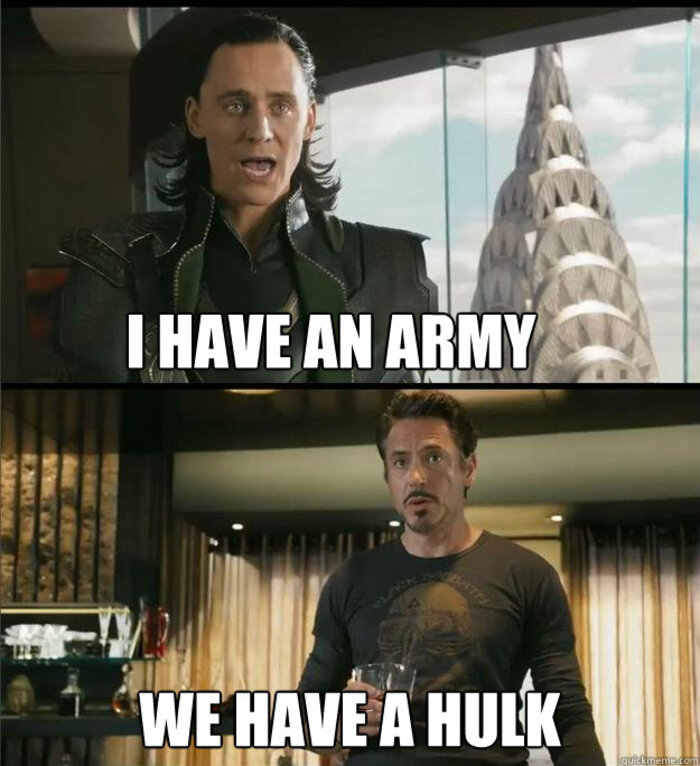
Boum. Ca suffit. Vous avez des rebelles, des djihadistes, des salafistes et on ne sait qui d’autres ? Nous avons American Sniper. Le succès considérable et inquiétant du film d’Eastwood vient de là. Pas de son patriotisme ou de son exaltation militaire (d’autres ont encore plus montré les muscles avant et ça n’a pas mieux marché), mais du fait qu’il est le premier film de super-héros pour les séniors. Un super-héros, invincible, charismatique et dont on pourrait faire des jouets, mais qui a existé pour de vrai. Plus Marvel que la Marvel, Eastwood pouvait même nous la faire à l’envers, à l’envers de Captain America en tout cas, puisque Chris Kyle, une fois libéré de ses obligations militaires, a fait plus ou moins la même chose que Steve Rogers (Captain America avant sa transformation) au début du film de 2011.

Au moins, nous aurions eu un aperçu de ce devenir icône qui dépasse le soldat et en fait une silhouette en carton pour l’armée, comme c’était le cas au début de… Mémoires de nos pères ! On l’avait oublié, ça semble si lointain, si lointain… Même le fait que Kyle soit devenu célèbre indirectement pour ses faits de guerre mais d'abord grâce à son bouquin se retrouve évincé du film, faisant passer les Américains pour des soiffards belliqueux, tellement impliqués dans la vie de leur armée qu’ils célèbrent spontanément leur petit ogre chéri (il s’appelle « Légende » et Eastwood ne montre pas de « Print The Legend » hérité de L'homme qui tua Liberty Valance ? On nous l’a changé cet homme, c’est pas possible…). Dommage, parce qu’Eastwood n’ignore pas le rôle décisif et actuel des médias comme relais concret de la guerre. Cet état de fait motive même deux des meilleures scènes du film.

Dans la première, l’épouse de Kyle est au téléphone avec ce dernier. Elle est sur un parvis paisible, au Texas, il est sous le feu des balles, en Irak. Elle crie, se tord dans tous les sens comme si elle-même était au combat. Illustration simple et percutante de l’infiltration de toute guerre, même la plus lointaine, à l’intérieur de la société civile : par le truchement médiatique, les affrontements ont un effet physique sur l’auditeur/spectateur et le plonge dans cet état d’exception devenu la règle dans les pays occidentaux. Deuxième jolie scène : Kyle assis dans son fauteuil, les yeux rivés sur sa télé. On ne voit pas l’écran, on entend le son, sûrement celui d’un reportage de guerre, mais à la fin du mouvement de caméra, l’écran est noir, éteint. Les bruits ne résonnent que dans la tête de Kyle. Les combats se sont infiltrés en lui et il les charrie où qu’il aille. On préfère l’épilogue de Jarhead : "les mains se souviennent". Ca dépassait les souvenirs, ça dépassait le cerveau, ça irriguait le corps à l’insu du vétéran. Le reste du drill, cette répétition inlassable des mêmes gestes jusqu’à en faire des automatismes. "Nous sommes toujours dans le désert" déclarait Jake Gyllenhaal pourtant de retour au pays après n’avoir rien fait de toute la Tempête du désert. On préfère l’expression du PTSD (l’acronyme américain pour le syndrome de stress post-traumatique) chez Sam Mendes, mais au moins Eastwood a la décence de montrer que la guerre ne glisse pas sur son héros comme l’eau sur le canard. Et puis, il n’en est que plus fort au final, le canard, c’est tout bénéfice. Y-aurait-il même un soupçon d’ambivalence ? La guerre, c’est bien et c’est pas bien à la fois, c’est vous qui voyez ?

Si American Sniper n’est pas loin de contenir l’antidote à son poison, c’est à son corps défendant, à force de se conforter dans un premier degré difficile à prendre au sérieux. Jarhead reluquait Full Metal Jacket pour ses séquences d’entraînement (ses soldats regardaient Apocalypse Now sans recul critique, n’y voyant que l’exaltation, et évitaient de peu de se faire une séance de Voyage au bout de l’enfer).

Dans des scènes équivalentes, American Sniper évoque plutôt Starship Troopers, la conscience du pastiche en moins. Paul Verhoeven et Edward Neumeier, son coscénariste, ont été malins sur ce coup. Ils ont dévoyé le roman de SF le plus militariste qui soit, œuvre de Robert Heinlein, non en le tournant en dérision, mais en le transcrivant avec la plus grande application. Les aberrations apparaissaient d’elles-mêmes, alors que chez Eastwood, elles ne sont visibles qu’au prix d’une injustifiable torsion post-moderne transformant tout en second degré. Starship Troopers rend en plus la blague douloureuse, un soldat meurt à l’entraînement : c'est l’ordalie (deviennent soldats ceux qui survivent) comme dans Full Metal Jacket. On ne forme pas d’esprit de corps sans casser d’œufs, mais les œufs d’Eastwood ont une coquille à toute épreuve, vraisemblablement par souci de véracité (personne n’est mort à l’entraînement sous les yeux de Kyle), sûrement parce que rien de vraiment mauvais ne doit sortir de là (même si sur ce point, l’épilogue du film est d’une triste ironie).
Et le plaisir de tuer dans tout ça ?
American Sniper est à l’Irak ce que Les Bérets verts ou Rambo 2 étaient au Vietnam : de la gloriole belliqueuse, par le réalisateur-acteur du Maître de guerre, film qui refaisait déjà l’invasion de la Grenade mais s’appuyait sur un vieux salopard au cœur tendre autrement plus revêche que le monolithique Chris Kyle incarné par Bradley Cooper. Si les tours du World Trade Center avaient été faites en ce Chris Kyle, les avions auraient rebondi dessus... La guerre : pas de gêne, du plaisir ! Kathryn Bigelow n’avait pas hésité à prendre cette dernière donnée, perturbante, à bras le corps, avec Démineurs. La guerre, quelle merde, quelle souffrance, et quel pied ! Dedans, on ne pense qu’à la quitter, dehors, on ne pense qu’à la retrouver, autant à cause de l'inadaptation irrémédiable à la vie civile que par accoutumance (l’adrénaline, la plus puissante des drogues). C’était une maîtresse SM. Quiconque a aimé le film se souvient du reset du compte-à-rebours à la toute fin, quand le nombre de jours avant le retour au pays atteignait zéro pour aussitôt croître.

Chris Kyle est drogué à la guerre, mais il n’est représenté comme tel. Dommage, encore, toujours. Il y avait le beau discours du père à Chris enfant : "Il y a trois catégories d’Américains, fils : les agneaux – et tu n’en seras pas un -, les loups – et tu n’en seras pas un non plus. Car tu seras un chien de berger". Sauf que chien de berger n’est pas une fin en soit, mais une étape dans l’inéluctable devenir loup.
Accros à la violence, soldats retournés contre les leurs : le cinéma américain lucide en est plein de ces détraqués, mais Eastwood n’en veut pas. Il dévoie le devenir loup in extremis sur un nouveau personnage, à la toute fin. Kyle reste un imperturbable Terminator. Il sent l’acier, pas la chair (étrange d’ailleurs qu’Eastwood le laisse même prendre des décisions alors que le vrai Kyle a écrit n'appuyer sur la gâchette que quand on lui en donnait l’ordre). C’est un fusil fait homme, peu prédisposé au dilemme alors que ce dernier tourmente le cinéma de guerre américain récent. Il était d’ailleurs au cœur de Zero Dark Thirty, coincé entre les deux temps du film, la vengeance et la justice. D’abord l’émotion et la revanche aveugle, la torture, ensuite la réflexion et la stratégie, au risque de l’immobilisme. La force du film tenait au fait qu’il s’avérait impossible de déterminer quelle étape était la plus efficace, ni de savoir à quel point elles étaient liées ou si même il était possible de faire avec une et sans l’autre.
Sniper et drone, même combat
Le dilemme habite également Good Kill, présenté à la Mostra de Venise et prochainement sur les écrans français. American Sniper a beaucoup à voir avec lui. Le film d’Andrew Niccol se concentre pourtant sur un pilote de drône, pas un soldat au cœur des combats, mais tous les deux prennent acte de l’asymétrie totale de la guerre à partir du moment où elle oppose des forces toujours tenues à distance du feu de l’action (francs-tireurs, drones) à des combattants impliqués, des corps qui mourront en même temps que leurs armes.

Eastwood et Niccol mettent en scène des meurtres préventifs : on n’y tue pas un agresseur avéré, on n’y tue des agresseurs potentiels, supposés (et la politique de surveillance par les drones a fait de la suspicion une mécanique arbitraire, car fonctionnant de proche en proche : vous devenez cible à partir du moment où vous avez un contact avec un contact ayant eu un contact avec un suspect). Le dénouement de Good Kill fera plus polémique qu'American Sniper, croyez-nous, mais ça n’empêche pas le reste du film de compter dans ses rangs des sortes de poètes-guerriers, des opérateurs de drones qui briefent et débriefent inlassablement leurs actions, s’interrogeant toujours sur leur bien-fondé. Le héros d’American Sniper ne se donne pas cette peine. Eastwood le statufie en Stakhanov de la mort, lui refuse le droit d’être intellectuel, ni même d’évoluer (il est d’ailleurs honteux de voir certains médias américains rapprocher la polémique entourant le film de celle qui avait accompagné Voyage au bout de l’enfer, tant leurs conclusions respectives sont opposées). Sa violence lâche est légitime parce que ses adversaires sont indignes. On pourra toujours dire que ses adversaires sont des cas particuliers, représentatifs d’aucun groupe, mais c’est une position difficile à tenir quand le seul ennemi identifiable d'American Sniper est surnommé "Le boucher", qu’il torture à la perceuse et collectionne les têtes… Rappelons ce proverbe K’mer : «c’est quand le moustique se pose sur ses testicules que l’homme comprend que la violence ne résout pas tout dans la vie». Cela fait visiblement trop longtemps qu’un moustique ne s’est pas posé sur celles de Clint Eastwood.
-
 JoChapeau
commentaire modéré Ordure. Ce n'est plus drôle.24 février 2015 Voir la discussion...
JoChapeau
commentaire modéré Ordure. Ce n'est plus drôle.24 février 2015 Voir la discussion... -
 JoChapeau
commentaire modéré (je ne le trouve pas génial je suis un peu déçu moi aussi mais je lui reconnais un aspect théorique passionnant et une grande cohérence)24 février 2015 Voir la discussion...
JoChapeau
commentaire modéré (je ne le trouve pas génial je suis un peu déçu moi aussi mais je lui reconnais un aspect théorique passionnant et une grande cohérence)24 février 2015 Voir la discussion... -
 romaingarcin
commentaire modéré comment passer totalement a coté d'un film qui ne traite non pas de la guerre et de sa justesse mais qui s'interesse uniquement au comportement de Chris Kyle, sans le glorifier a aucun moment...27 février 2015 Voir la discussion...
romaingarcin
commentaire modéré comment passer totalement a coté d'un film qui ne traite non pas de la guerre et de sa justesse mais qui s'interesse uniquement au comportement de Chris Kyle, sans le glorifier a aucun moment...27 février 2015 Voir la discussion... -
 ProfilSupprime
commentaire modéré Excellent dossier16 octobre 2018 Voir la discussion...
ProfilSupprime
commentaire modéré Excellent dossier16 octobre 2018 Voir la discussion... -
 crococherbo
commentaire modéré j"adore Clint et tout ce qu'il fait!5 février 2016 Voir la discussion...
crococherbo
commentaire modéré j"adore Clint et tout ce qu'il fait!5 février 2016 Voir la discussion... -
 crococherbo
commentaire modéré après avoir vu plusieurs fois le film"AMERICAN SNIPER", son sujet, (pas facile!) je jeu des acteur (excellent)la mise en scène, ,les images fortes et les scènes dures et insoutenables. En fait Clint nous a sensibilisé sur la guerre, et toutes ses atrocités que l'on soit simple soldat des forces spéciales, ou tireur d'élite ou gradés. Il montre la guerre sous sa forme la plus dure (et encore on a pas les odeurs) et les conséquences dévastatrices pour l'humain. Je hais la guerre et CLINT aussi..5 février 2016 Voir la discussion...
crococherbo
commentaire modéré après avoir vu plusieurs fois le film"AMERICAN SNIPER", son sujet, (pas facile!) je jeu des acteur (excellent)la mise en scène, ,les images fortes et les scènes dures et insoutenables. En fait Clint nous a sensibilisé sur la guerre, et toutes ses atrocités que l'on soit simple soldat des forces spéciales, ou tireur d'élite ou gradés. Il montre la guerre sous sa forme la plus dure (et encore on a pas les odeurs) et les conséquences dévastatrices pour l'humain. Je hais la guerre et CLINT aussi..5 février 2016 Voir la discussion... -
 ProfilSupprime
commentaire modéré @cath44 je t'encourage vivement à lire cette article.16 octobre 2018 Voir la discussion...
ProfilSupprime
commentaire modéré @cath44 je t'encourage vivement à lire cette article.16 octobre 2018 Voir la discussion... -
 cath44
commentaire modéré @palewin cet article , je l'ai lu bien évidemment8 février 2016 Voir la discussion...
cath44
commentaire modéré @palewin cet article , je l'ai lu bien évidemment8 février 2016 Voir la discussion... -
 Bosco
commentaire modéré "Clint Eastwood a-t-il fait une grosse connerie avec American Sniper ?" C'est bien le genre d'interrogation torve (le point d'interrogation est parfaitement hypocrite) qui serait à la noix si elle n'était pas là pour jeter le voile de suspicions et des troubles sur des œuvres fortes mais qui déplaisent à l'orthodoxie du jour que de bons esprits VK ou Télérama, jouant leur rôle de tribunes de prêches, sèment dans l'esprit de leurs assistances.30 janvier 2021 Voir la discussion...
Bosco
commentaire modéré "Clint Eastwood a-t-il fait une grosse connerie avec American Sniper ?" C'est bien le genre d'interrogation torve (le point d'interrogation est parfaitement hypocrite) qui serait à la noix si elle n'était pas là pour jeter le voile de suspicions et des troubles sur des œuvres fortes mais qui déplaisent à l'orthodoxie du jour que de bons esprits VK ou Télérama, jouant leur rôle de tribunes de prêches, sèment dans l'esprit de leurs assistances.30 janvier 2021 Voir la discussion... -
 Nadee_BKK
commentaire modéré @Bosco Tout à fait d'accord !31 janvier 2021 Voir la discussion...
Nadee_BKK
commentaire modéré @Bosco Tout à fait d'accord !31 janvier 2021 Voir la discussion...
















