Cannes 2015 : A la recherche de la nouvelle star du cinéma mondial
Pour mon tout premier Festival de Cannes, j'ai souhaité m'intéresser aux cinéastes dans la même situation que moi : ceux dont c'était aussi la première fois. Alors qui parmi eux a la trempe de Steven Soderbergh, Quentin Tarantino ou Xavier Dolan ? Je suis parti à la découverte de ces premiers longs-métrages armé de mes petites jambes, de mon accréditation bleue et de mon iPhone 4 (même pas S).

Une toute petite queue pour un géant
Une journée d'échauffement, passée devant le film d'ouverture du Festival et un film de la compétition, et il est temps pour moi de partir à la recherche des nouveaux talents. En bon festivalier débutant, je sais une chose : si je souhaite découvrir des auteurs débutants, la Semaine de la Critique est toute indiquée, car son principe est de ne présenter que des premiers et seconds longs-métrages. Le jeudi 14, jour de l'ouverture de cette section, je suis donc là, pour voir un film canadien qui a tout pour me plaire a priori: Sleeping Giant, que son réalisateur Andrew Cividino décrit comme un croisement entre Stand By Me et Sa Majesté des Mouches. Vaste programme.

Après avoir fait à peine 3mn20 de queue (ça change de l'heure et demi nécessaire pour voir un film de la compétition), je pénètre dans une salle déjà bien remplie. Moi qui pensais qu'un premier film canadien n'intéresserait que moi... Petite présentation de l'équipe, avec ses jeunes comédiens portant leur costume le plus grand et leur casquette la plus à l'envers, et mon premier premier film de Cannes démarre. S'il retranscrit parfaitement l'atmosphère de fin de vacances et sa mélancolie, le twist dramatique trop prévisible de Sleeping Giant et son incapacité à sortir des sentiers battus de la "coming of age story" typiquement indée, jouent contre lui. Le premier essai d'Andrew Cividino n'est donc pas totalement transformé, mais n'a rien de honteux non plus, grâce au naturel des comédiens et à sa mise en scène soignée (avec en particulier un très beau sens du cadre). Du coup je suivrai quand même son parcours, à ce p'tit jeune...

Sus au survendage !
Le lendemain, un autre genre de premier film à mon programme : Ni le ciel, ni la terre du français Clément Cogitore, jeune homme au parcours atypique, ce qui se ressent sur ce premier long-métrage qui mélange film de guerre et film surnaturel. Lors de sa présentation, un journaliste membre du comité de la Semaine de la Critique nous le survend quand même un peu en le désignant comme un croisement (décidément…) entre John Ford et M. Night Shyamalan. Avouez que c'est intrigant.

Le résultat ? Eh bien c'est pas mal. Tout est fait pour que l'on se pose des questions, que l'on tente de combler les blancs de l'histoire, et la partie surnaturelle, presque métaphysique, du récit a tout pour plaire. Mais à force de vouloir jouer la carte du mystère à tout prix, Clément Cogitore oublie de raconter son histoire, et pire encore, de la terminer. Dommage vu ce que le film promettait sur le papier... Néanmoins, ce jeune homme a indéniablement une patte et une volonté de traiter le film de genre (surtout à la française) différemment. Alors rien que pour ça, il a tout mon intérêt. Et je suis sûr que ça lui fait une belle jambe.

Hippie hippie shake
La fameuse magie de Cannes, c'est de pouvoir passer, en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, de l'hystérie "maïwennesque" (j'invente des mots si je veux… ça aussi, c’est la magie de Cannes), à un premier film palestinien consacré exclusivement à un salon de coiffure pour femmes : Dégradé, réalisé par les frères jumeaux Tarzan et Abu Nasser (des pseudos évidemment). En débarquant sur la scène de la Semaine avec leur look mi-hippie mi-gourou (entourés de quelques beautés venues d'Orient), ces deux-là ont déjà gagné toute ma sympathie.

Le film n’est pas exceptionnel, d'accord, mais il a au moins le mérite de traiter son sujet de manière originale : on ne sort quasiment jamais de ce salon de coiffure (excepté à la toute fin) dont les clientes montrent chacune un visage meurtrie de la Palestine. C’est un brin répétitif, bourré de maladresses, mais les frérots arrivent à gérer la montée de tension aussi bien qu’ils savent insérer des petites pointes d'humour pile quand c’est nécessaire. Et les comédiennes sont formidables. À nouveau pas un grand film, mais des réalisateurs à surveiller et que je remercie de m'avoir lavé les yeux après le calvaire "maïwennien" (hop ! encore un nouveau mot) de la projection de Mon roi au saut du lit.

Un fanboy déçu par le cowboy
Le lendemain, deux films de la Compétition plus tard, je repars à la découverte de jeunes talents, plus confiant que jamais puisque le prochain candidat s'appelle Les Cowboys. Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs (la Semaine de la Critique n'a pas le monopole des premiers films), voilà un film que j'attends particulièrement pour deux raisons : François Damiens - j'y peux rien, je suis fan, je vais voir tous ses films y compris Torpedo, Tip Top et Une Pure Affaire… fan, je vous dis - et Thomas Bidegain, réalisateur, jusqu'ici scénariste reconnu de De Rouille et d’Os, A perdre la raison, Saint Laurent et La Famille Bélier (parce qu’il faut bien bouffer, aussi). Fun fact : il est en fait doublement présent dans cette édition 2015 du Festival, puisque le Palmé Dheepan a également été écrit par ses soins. A ce moment là, on ne sait pas que Dheepan gagnera la Palme, et l'attente est déjà énorme.
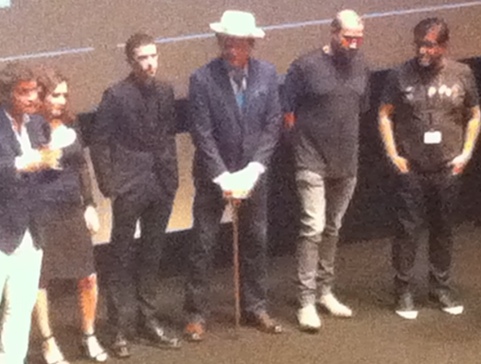
Malheureusement, comme trop souvent, qui dit grosse attente dit grosse déception. C’est le cas ici, avec ce script presque trop écrit, trop ambitieux pour les frêles épaules d'un cinéaste débutant. En plus, ne connaissant quasiment rien du pitch avant de débarquer au Théâtre Croisette de la Quinzaine, je suis surpris de constater qu'il s'agit en fait de l’histoire très sombre d'une famille dont la fille part faire le Djihad, et de la quête du père (puis du fils) pour retrouver leur chère disparue... À en croire les réactions extatiques des spectateurs encore présents en fin de projection, je suis visiblement le seul à émettre des réserves. J'aurais aimé pouvoir donner mon avis pendant le Q&A, mais étant assis au balcon avec les pauvres, aucun micro ne passe à ma proximité. Je repars donc la tête basse et des questions plein la tête.

Indien vaut mieux que deux tu l'auras
Le film de Bidegain m'inquiète quant à ma condition : aurais-je le coeur sec ? La réponse vient du film suivant, cinglante : non ! Songs My Brothers Taught Me me bouleverse. Réalisé par Chloé Zhao, jeune cinéaste d’origine chinoise ayant fait ses études en Angleterre, le film s'intéresse à une communauté rarement filmée : celle des indiens d'Amérique parqués dans des réserves. Interprété principalement par des comédiens amateurs justement recrutés dans la réserve indienne où se déroule l'histoire, Songs My Brother Taught Me m'a touché au plus profond de mon petit coeur.

Le film prend place dans le Dakota du Nord. On suit principalement Johnny et sa jeune soeur Jashaun, quasiment orphelins (le père est décédé et la mère alcoolique). En plus de montrer sans pathos la misère sociale de ce type de communautés en vase clos, les paysages et les relations fraternelles filmés par Chloé Zhao ressemblent à du Malick. Pendant les scènes d'errance dans les « badlands », il est impossible de ne pas penser au film de Terrence Malick du même nom. Je décerne donc à ce premier essai subtil et délicat ma Palme du coeur. Ce terme, honni par certains (je sais qu'ils me lisent), lui sied à merveille, et dans mon forfait newbie, il est indiqué que j'ai le droit de l'utiliser, cette année seulement... J'ai d'ailleurs l'occasion de le dire à la fin de la projection, lors du traditionnel Q&A, me jetant sur le micro pour crier tout mon amour à l'équipe du film, présente sur scène. Avant d'être appréhendé par les autorités, pour avoir tenté d'arracher une mèche de cheveux à la réalisatrice.

Après le coup de coeur, le coup de gueule
Krisha, lui, mérite un tout autre prix : celui du film-de-p'tit-malin-hyper-énervant. Ça part mal dès la présentation de l'équipe. Les comédiens, chef-opérateur, producteurs et compositeurs arrivent au compte-gouttes sur la scène de la Semaine, arborrant tous un air extrêmement sympathiques, quand enfin arrive le réalisateur : Trey Edward Shults. Pardonnez-moi par avance de juger sur les apparences, je sais que ce n'est pas très correct… mais le mec, avec sa dégaine d'américain typique (après le combo costume trop grand/casquette de baseball à l’envers, voici l'assortiment costume/claquettes), sa mâchoire carrée et ses dents anormalement blanches, sent l'arrogance à plein nez. Son film est à son image. Le cinéaste use et abuse de grotesques effets de style, s'amuse à faire tournoyer sa caméra n'importe comment, avant de céder à l'hystérie la plus totale dans les 20 dernières minutes (Maïwenn n'est pas loin). À la fin de la projection, pourtant, une majorité de spectateurs réserve une standing ovation à l'équipe du film, qui elle est en larmes. Pour ma part, je préfère m'esquiver discretos vite fait, après avoir sérieusement envisagé l'idée de cracher au visage de quarterback du réalisateur. J'ai jamais aimé les quarterbacks.

Rencontres avec le Fils de Saul et le frère de Danny (Elfman)
Je me souviens de ma réaction nettement moins hostile après avoir découvert le gros morceau du Festival, le seul premier long-métrage en Compétition : Le Fils de Saul, du jeune cinéaste hongrois Laszlo Nemès. Nous en sommes alors au 3ème jour du Festival et les attentes sont élevées, puisque Thierry Frémaux a présenté le film comme une oeuvre potentiellement à scandale, lors de la conférence de presse d'annonce de la Sélection. Au final, pas d'outrage, mais un choc résultant de l'immersion au coeur de l'infernale machine de destruction mise en place par les Nazis. Nemes choisit de suivre son personnage (le Saul du titre) pour ne jamais le lâcher. Ce qu'il voit, le spectateur le voit aussi. Et inversement : ce qu'il ne voit pas, ou ne distingue pas, le spectateur ne le voit pas non plus. Les cadavres en arrière-plan restent dans le flou. Saul est ici pour accomplir son travail de Sonderkommando, et rien ne peut le détourner de son horrible tâche. Jusqu'à ce qu'il tombe sur le corps de son propre fils.

J'ai justement la chance d'interviewer le réalisateur. C'est la gorge sèche et les mains moites que je me dirige vers la Plage du Majestic, sorte de bunker en plein air dans lequel on entre après avoir passé deux services de sécurité pas hyper commodes. Me voilà donc projeté au milieu de réalisateurs, producteurs et journalistes professionnels, où l'on me demande gentiment si je désire boire quelque chose. Pris de court, j'opte timidement pour de l'eau, alors qu'un cocktail rhum-pêche-banane me fait de l'oeil. Installé confortablement sur un grand fauteuil en tissu gris qui donne envie de s'affaler de tout son long, je salue László qui vient de terminer une autre interview. Il a l'air épuisé, mais le jeune homme est extrêmement intelligent et réfléchi, en plus de s'exprimer dans un français absolument parfait (il a vécu à Paris pendant près de 15 ans). Quand je lui demande ce que ça lui fait d'être en lice pour la Palme dès son premier film, le jeune réalisateur ne s'enflamme pas : "Nous, on aurait déjà été content d'être sélectionnés à Un Certain Regard. Eux nous on dit qu'ils préféraient qu'on aille en Compétition, donc on ne pouvait pas refuser cette proposition. C'est une responsabilité, une pression, une opportunité. C’est un peu le vertige, cette situation."

S'attaquer à un sujet aussi lourd et imposant pour un premier essai n’est pas chose aisée. Pourtant, cela semblait essentiel pour lui : "Je pense qu’il y avait la place pour un film qui présente une expérience des camps de manière différente de ce qui a fait jusque-là. J’avais la conviction que ce film devait être fait". Mais de quelle manière ? Pendant tout le film, je ne cessais de penser au travail d'Emmanuel Lubezki, chef-opérateur des films d'Alfonso Cuaron et Alejandro Gonzalez Inarritu. Nemes confirme qu'il s'agissait bien de son modèle : "Quand j’ai vu Les Fils de l'Homme, je me suis dit : "voilà, lui il essaie de faire des trucs qui m’intéressent !". Sauf qu'il avait un grand angle et 20 fois plus d’argent que nous !". A ce moment-là, nous sommes interrompus par deux personnes qui viennent s’asseoir à côté de nous. L’attachée de presse les prie gentiment d’aller siroter leurs cocktails un peu plus loin, sauf que l'une de ces personnes n'est autre que Richard Elfman, lui aussi réalisateur et frère de Danny, le compositeur de musique de film (dont je suis fan). Ce que je m'empresse de préciser à László. "On vient de virer le frère de Danny Elfman ? Oh my fucking god !" dit-il en riant.

Fin de l'interlude inattendu (la suite au dernier paragraphe) et reprise de notre entretien : "Il y a dans mon approche de l’espace et de l’individu quelque chose d’organique que l’on retrouve chez Cuaron, mais aussi chez Ellem Klimov (NDA : réalisateur de Requiem pour un massacre, autre référence assumée), Paul Thomas Anderson… Le cinéma pour moi, c’est ouvrir des portes dans la tête des spectateurs. Or le cinéma travaille de plus en plus contre l’imagination du spectateur, qui a tendance à se désengager de ce qu’il voit". Et moi d'acquiescer avec force, sans pour autant m'empêcher d'émettre des réserves à l'égard de son personnage principal déshumanisé, auquel le spectateur risque de ne pas s'attacher : "Le film est justement une réponse à ça. C'est une immersion dans son monde. À la fin du film, le spectateur a compris quelque chose de ce monde là et, rétrospectivement, arrive à saisir l’âme de ce qu’il s’est passé dans ces camps. C’est là où le film est différent des autres, je pense". Différent, il l'est à n’en pas douter. Au moins grâce à son procédé de mise en scène, jamais vu dans ce type de films : "C'était un prototype. Avec le chef-opérateur et le monteur, nous savions que nous étions sur des territoires inconnus. C'était aussi un défi constant, de savoir comment maintenir l'ensemble cohérent."

Après toutes ces questions relatives à son film, je veux en savoir un peu plus sur son Festival de Cannes à lui. Est-ce possible de sortir de la promo et des invitations à diner, pour pouvoir assister à quelques projections ? "Pas du tout. Ce Festival m'a assommé" répond-t-il. Mais sa première montée des marches l'a en revanche très ému : "Je pensais que ce n’était qu’un protocole, mais c'était une cérémonie presque spirituelle. Nous étions en véritable communion avec toute l’équipe du film". Après ça, le quotidien d’un jeune cinéaste dont c’est le premier Festival paraît moins exaltant : "Je ne fais rien, je ne sors pas : je suis juste la prostituée des journalistes !". Il blague, bien sûr, d'autant plus qu'après avoir été interviewé par 70 journalistes avant moi, il me glisse malicieusement que je suis celui qui lui a posé les questions les plus intéressantes. Il a peut-être dit la même chose à chaque intervieweur, je m'en fiche : en tant que newbie, permettez-moi de me la péter un peu.
En attendant de faire un volley avec Gus Van Sant
Il n'empêche, vous l’aurez compris, ma Caméra d'Or, je la décerne au magnifique Songs My Brothers Taught Me, juste devant Le Fils de Saul. Et la véritable Caméra d'Or, demanderez-vous ? Celle remise au film colombien La Tierra y la Sombra de César Augusto Acevedo ? Eh bien je n’ai pas vu le film. La lose. Car c’est surtout ça, Cannes : imaginez un gamin dans un magasin de jouets à qui on dit « Vas-y, tu peux en prendre plein, c’est gratuit ! Mais va juste falloir choisir, tu peux pas tous les prendre non plus ». Voilà pendant 12 jours ce qu'a été mon quotidien : de la pellicule à foison, à ne plus savoir quoi en faire. Il fallait forcément faire des choix, et tous n'ont pas été bons (coucou Valérie Donzelli !). Le Festival de Cannes, là où on apprend que le plaisir de la découverte ne va jamais sans frustration.

Et Richard Elfman, dans tout ça ? Oh trois fois rien. Je suis allé le saluer une fois l'interview de Laszlo Nemes terminée, et après avoir échangé nos cartes de visite respectives, nous avons convenu de boire des coups deux jours plus tard, au même endroit. Ce que nous avons fait. Nous avons parlé de vins avec Brian Yuzna (réalisateur du Dentiste, Re-Animator 2 et Society), puis mon nouveau meilleur ami "Dick" en a profité pour m'inviter à un barbecue chez lui cet été à L.A. En me promettant que nous ferions des parties de beach-volley avec son frère Danny et Gus Van Sant. Trois fois rien, donc.
-
 theocinosh
commentaire modéré La fraîcheur d'un regard neuf sur un vieux festival : on prend plaisir à lire ce compte-rendu pas comme les autres. Vivement #Cannes2016 !1 juin 2015 Voir la discussion...
theocinosh
commentaire modéré La fraîcheur d'un regard neuf sur un vieux festival : on prend plaisir à lire ce compte-rendu pas comme les autres. Vivement #Cannes2016 !1 juin 2015 Voir la discussion... -
 Flol
commentaire modéré @theocinosh Merci ! J'espère que j'y serai aussi, à cette édition (main dans la main avec Gus).1 juin 2015 Voir la discussion...
Flol
commentaire modéré @theocinosh Merci ! J'espère que j'y serai aussi, à cette édition (main dans la main avec Gus).1 juin 2015 Voir la discussion... -
 elge
commentaire modéré Sympa, l'angle... ceci étant dit, est-ce qu'on détecte avec un seul film les stars de demain ? ... ça me fait penser à Justin Kurzel, qui avait présenté un film violent et misérabiliste, "les crimes de Snowtown" à la semaine de la critique, qui présente un film "de stars" cette année, "Macbeth", et qui va gagner du fric l'année prochaine avec "Asssassin's Creed" ... ça sent le plan de carrière de celui qui s'est dit qu'il devait réussir des "examens" de passage...1 juin 2015 Voir la discussion...
elge
commentaire modéré Sympa, l'angle... ceci étant dit, est-ce qu'on détecte avec un seul film les stars de demain ? ... ça me fait penser à Justin Kurzel, qui avait présenté un film violent et misérabiliste, "les crimes de Snowtown" à la semaine de la critique, qui présente un film "de stars" cette année, "Macbeth", et qui va gagner du fric l'année prochaine avec "Asssassin's Creed" ... ça sent le plan de carrière de celui qui s'est dit qu'il devait réussir des "examens" de passage...1 juin 2015 Voir la discussion... -
 Flol
commentaire modéré @elge C'est vachement bien, les Crimes de Snowtown.1 juin 2015 Voir la discussion...
Flol
commentaire modéré @elge C'est vachement bien, les Crimes de Snowtown.1 juin 2015 Voir la discussion... -
 elge
commentaire modéré @Flol Pas vraiment pour moi (et de moins en moins, d'ailleurs)1 juin 2015 Voir la discussion...
elge
commentaire modéré @Flol Pas vraiment pour moi (et de moins en moins, d'ailleurs)1 juin 2015 Voir la discussion...
















