Votre réalisateur fétiche est-il condamné à vous décevoir, tôt ou tard ?
L'année 2015 démarre étrangement pour la planète cinéma. Alors qu'on l'annonçait riche et radieuse, grâce au retour d'auteurs attendus (Terrence Malick, Michael Mann, les Wachowski, Tim Burton), la voilà qui commence par décevoir. Vu de Berlin où il était en compétition, le dernier Malick a fait l'effet d'un sabotage caricatural, au point de nous avoir encouragé à en faire un bingo ; le nouveau Mann est une désillusion cruelle pour certains fans de Miami Vice ; le space opera des Wachowski n'a pas soulevé de joie les défenseurs de Cloud Atlas ; etc. Alors, on finit par se demander : usure du cinéaste ou lassitude du spectateur ?

La relation qui unit un spectateur et son réalisateur fétiche est finalement toute passionnelle. On s'aime, on se déchire, on espère. On le rejette parfois, dans l'attente de retrouver ce qui chez lui nous a fait vibrer au tout début, lui demandant toujours de transformer l’essai, de réitérer la magie... mais gare à lui s'il fait continuellemnt la même chose. Ce douloureux paradoxe place souvent le réalisateur chouchou dans une situation inextricable, le condamnant à inévitablement décevoir. Il y a toujours ce film qui opère un basculement, qui "rend la vue" si l'on peut dire, transformant les qualités d'avant en défauts d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui caractérise le "film de trop" et quels sont ces réalisateurs avec lesquels l'alchimie n'opère plus ?
Le fourvoiement artistique
Le nouvelle est tombée comme un couperet : Tim Burton va se charger de l’adaptation live de Dumbo, le classique des studios Disney, perdant sans doute les derniers irréductibles qui s’accrochaient encore désespérément aux lambeaux de cinéma du maître poético-gothique. Tim Burton aura fait rêver petits et grands grâce à des oeuvres inscrites à jamais dans l’histoire du cinéma et dans nos coeurs : Edward aux mains d’argent, Beetlejuice, Batman, Sleepy Hollow… Mais plus le succès est grand, plus vertigineuse sera la chute. Et le cinéaste n’échappe pas à cette règle cruelle en se fourvoyant artistiquement. Le déclin s’est fait progressivement, alternant succès réjouissants et petites baisses de tension (La Planète des singes, Charlie et la chocolaterie, Sweeney Todd) mais le véritable coup de grâce fut sa reprise en main du conte Alice au pays des merveilles, taxé de produit industriel, dénué de la magie caractéristique de son cinéma d’autrefois.
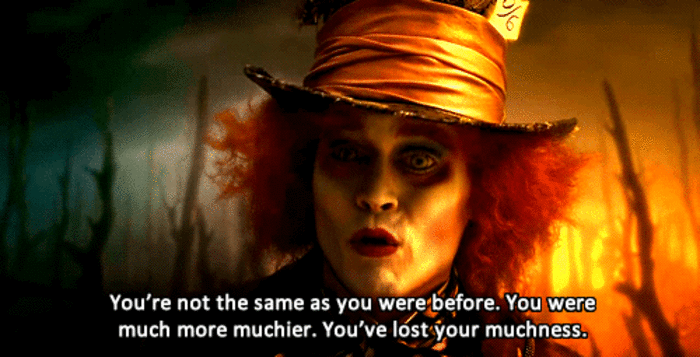
Les fans de la première heure furent peu nombreux à adhérer à son Alice, qui aura peut-être en revanche trouvé une nouvelle case dans laquelle se ranger : les films d’aventure à voir en famille, tel un triste descendant de Narnia. Avec lui, Burton s'est créé un autre public, mais il a perdu le plus important : la fidélité de cette communauté en adoration devant ses films d'antan, créations pleines de merveilleux, de fantaisie, de baroque, de tendresse et de noirceur tout à la fois. Après Alice, Dark Shadows ne trouva pas davantage grâce aux yeux des fans de la première heure et, malgré un sursaut d’espoir avec Frankenweenie (qui le ramenait sur les rives de ses premières amours, entraînant avec lui ses dévoués nostalgiques), Big Eyes ne convainc guère plus. On reproche aussi à Tim Burton de toujours exploiter les mêmes ressorts, la même esthétique, de trop faire jouer Johnny Depp, de trop faire du Burton, en somme de ne plus rien inventer.
N'être plus que l'ombre de soi-même

Terry Gilliam suit la même trajectoire. Il a épaté avec Brazil, L’Armée des 12 singes, Las Vegas Parano, avant de connaître une période de revers dont il ne semble pas devoir se relever, une longue infortune amorcée par... Les Frères Grimm. Encore une fumeuse histoire de contes, décidément... Sauf qu'à la différence de Burton, Gilliam s'est planté artistiquement et financièrement, perdant des plumes auprès de ses supporters sans pour autant se ragaillardir avec de nouveaux initiés. Son dernier film en date, Zero Theorem, donne raison à ses détracteurs, aux amers et aux déçus, prouvant que l'absurdité et l'inventivité de Brazil ne subsistent plus qu'à l'état de reliques, tellement tristes qu'elles en arrivent presque à vous faire passer l'envie de revoir son chef-d'oeuvre. Gilliam a commis un impair avec ce qui apparaît comme un pastiche, l'ombre bien triste - et à l’imagerie bien creuse - de l'inégalable Brazil. Son film précédent, L'imaginarium du docteur Parnassus, n'a pas non plus satisfait ses disciples. Ces derniers sont-ils devenus trop exigeants au fil du temps, comme des profs qui en demanderaient toujours plus au surdoué de la classe ? Le bon élève Terry Gilliam, dont les satires sociales teintées d'onirisme ont bouleversé une grande majorité de spectateurs, ne séduit plus. On lui reproche d'être finalement brouillon, excessif, caricatural, emphatique... On ne voit plus de folie chez Gilliam, mais de l'"hystérie". C'est le danger quand on a un style ausi affirmé, parfaitement identifiable, et que vos fans changent ou simplement s'habituent à votre marque de fabrique.
Quand le cinéaste s'embourbe dans la parodie

Terrence Malick est de ceux là. Lui, c'est sûr, ne fait pas partie des réalisateurs anonymes dont on ne sait même pas qu'ils sont derrière la caméra et qui ne connaîtront jamais de retour de bâton (ni la gloire, fort heureusement). On peut même dire qu'il enfonce le clou à chaque film depuis Tree of Life. Quel est le risque de l’enfonçage de clou ? Tout simplement d'en arriver à commettre une parodie de ses propres films, à force de répéter en boucle les mêmes motifs esthétiques et les mêmes thèmes (la solitude, la nature panthéiste, l’amour, la spiritualité) inlassablement jusqu’à l’indigestion, faisant de chaque nouvelle réalisation une énième variation autour de son oeuvre, déclinant à l’infini sa marque de fabrique. Ne parlons pas de déchéance - Malick n’en est pas encore là ! - mais demandons-nous si les qualités de son cinéma ne finissent pas par devenir ses défauts. Aussi A la merveille en a déçu et lassé plus d’un. Quant à Knight of cups, il semble emprunter cette même voie pavée de désillusions.
Une autre réalisatrice à l’univers esthétique très personnel et aux thèmes ressassés, Sofia Coppola, réalisatrice des merveilleux Virgin Suicides et Lost in translation, semble en proie au même type de désamour. Le déclin a commencé avec Marie Antoinette, avant que Somewhere ne l'accentue (en dépit de son Lion d'Or) et que The Bling Ring n'achève de la ranger pour de bon dans la case des "réalisateurs qui font toujours la même chose". Les spectateurs ont appris à anticiper son cinéma, vite devenu prévisible. Ils ont commencé à se lasser de ce qui avait pourtant fait la renommée de Sofia Coppola. La langueur de son cinéma - à l’image de ses héroïnes, petites filles riches chagrines et désabusées - est devenue synonyme d’ennui. La douce mélancolie de ses plans est devenue synonyme de vacuité. Le caractère contemplatif de ses films est devenu poseur.

Le premier chef d'oeuvre, forcément inégalable ?
Est-il possible que l’on en attende trop de ceux que l'on a adulés ? Sommes-nous condamnés à brûler nos idoles ? Cette descente aux enfers, c’est peut-être l’histoire de notre éternelle insatisfaction, de nos amours passéistes, de nos rêves d’enfants à jamais révolus. Le dépit commence toujours par la trahison, sentiment ne pouvant faire suite qu'à un amour sincère et passionné. Peut-être que si les réalisateurs sont condamnés à nous décevoir, c’est parce qu’on les aime un peu trop fort et qu’on n’arrive pas à se détacher de ces films qui nous ont tant fait vibrer ; car la première fois, finalement, on vibre toujours un peu plus. C’est la découverte de l’émotion, l’apprentissage de sensations nouvelles, le bonheur de se retrouver qui caractérisent nos premiers émois cinématographiques. Et finalement survient un jour la désillusion. Peut-être que les films sont effectivement moins bons, moins portés par la fougue des premiers projets, mais peut-être aussi sommes-nous tombés dans le désenchantement de la routine. Les chefs-d’oeuvre tant aimés ont cette inestimable valeur car ce sont des moments de magie précieux qui ne peuvent se produire qu'une fois. Ils sont voués à rester rares, à se muséifier, à s'inscrire au panthéon des films inégalables, au point que l'on refuse, de manière inconsciente, que les créations suivantes puissent renouer avec cette chère magie (dont l'aura grandit en plus en nous, avec le temps). Car le cinéma, c'est un peu comme la magie justement, une fois qu'on a compris le tour, on n'est plus mystifié.
Un rescapé de la malédiction

Il demeure aujourd'hui un contre-exemple à ces chroniques du désamour : Wes Anderson. Plébiscité par la critique et le public, sa popularité ne semble pas fléchir. Son dernier film, The Grand Budapest Hotel, a conquis les Oscars et les BAFTA. Anderson, sorte de grand enfant à l’inextinguible créativité, ne cesse de nous proposer des pépites, insufflant de l’âme aux maisons de poupées de son imaginaire. Pourtant le même écueil que celui de Terrence Malick ou Sofia Coppola le menace : une identité visuelle reconnaissable au premier coup d'oeil, facile à caricaturer (surcadrage et symétrie, effets comiques et poétiques liés à la statique du tableau, combinaisons de couleurs vives et complémentaires), et des thématiques récurrentes (la famille, la communauté, les parias). La différence tient peut-être au fait que Wes Anderson apporte toujours - au delà de l’esthétique et de l’univers très travaillés de ses propositions - un soin tout particulier à ses personnages, qui ne sont jamais de froides figures inanimées, ni des incarnations systématiques des obsessions de leur auteur, mais des êtres tangibles. Pour l’instant sa poudre magique fonctionne toujours, mais combien de temps faudra-t-il, avant que là aussi, ses effets ne se dissipent ?

















J'attends évidemment de voir ce qu'il nous réserve pour la suite.
Sinon sur TGBH (on dirait le nom d'une nouvelle drogue), Zweig n'était qu'un prétexte. A aucun moment Anderson n'avait l'idée, ni même l'ambition, d'adapter du Zweig ; il s'agissait simplement de s'inspirer de l'atmosphère de ses écrits. Et pour ma part, il retranscrit plutôt pas mal cet aspect de vieille Europe.
Et en effet, comme tu dis, il retranscrit à merveille l'atmosphère. ais c'est justement ce qui me chiffonne. Un trop plein d'ambition qui pèse un peu sur ses personnages.
Je ne l'ai pas revu cela dit, et peut-être que ça changerait la donne.
Le problème est-il dans l'oeuvre ou dans le regard d'une partie (ou même la majorité) des spectateurs ?
Pour donner un exemple stupide, je suis sûr que l'évolution des Beatles a laissé des midinettes de la première heure sur le côté..
Faut-il citer l'accueil critique et public de La Fille de Ryan ou La Route des Indes pour Lean ou celui de La Porte du Paradis ou L'Année du Dragon pour Cimino ?
A titre personnel, à Venise To the Wonder m'avait transporté, créant pour quelques temps à la sortie de la salle par deux fois, une certaine transfiguration de la réalité. Pas de phénomène similaire pour Knight of Cups à conter. En revanche, jamais je n'ai vu quelque chose de pareil, c'est une expérience cinématique extraordinaire et si singulière par ses fulgurances visuelles et sonores qu'il serait plus encore que pour les précédents films hasardeux de vouloir la hiérarchiser par rapport aux précédents films .. il ne me semblerait en aucun cas absurde d'écrire moi-même ou de lire chez quelqu'un d'autre que c'est peut-être le meilleur film du cinéaste texan.. (je veux dire par là que le film n'est pas hors concours en la matière). Mais comme je l'ai dit devant un film alignant tant de fulgurances, difficile de hiérarchiser, je n'en sais donc fichtre rien..